L'eau,
dans l'univers connu
!
Préambule (un peu de rappel
d'astronomie), ou passer ce
chapître :
Rappel des mesures utilisées en accord avec le Système
International (SI),
- Unité astronomique (UA),
Lors de la 28e Assemblée générale de
l’Union Astronomique Internationale, tenue fin août
2012 à Pékin (Chine) l’unité
astronomique (en anglais : astronomical unit (of
length) ou "au" ) a étté définie comme
valant exactement 149 597 870 700
mètres [+/-3 m] de
valeur fixe recommandée - (lien
fichier pdf
UAI)
Cela représente un parcours d’une durée de
499,004 s (soit 8 min 19 s) à la
vitesse de la lumière dans le vide.
- (soit 4,8481×10-6 parsec, ou
15,812×10-6 année lumière) -
- Une année-lumière (al) = distance
parcourue par la lumière dans le
vide (symbole anglophone "ly", pour light
year),
(NB - Depuis 1983, et avec la nouvelle
définition du mètre, la valeur de la vitesse de la
lumière est fixée à 299 792 458 m/s),
et en une année julienne de
365,25 jours solaires moyens, soit 31 557 600 secondes
(principalement utilisée dans les
éphémérides).
- Nota : calcul > [299 792 458 m/s x
31 557 600 s] = 9 460 730 472 580 800 m
(9 460 730 472 580,8 km) ou 9 461
milliards de km environ, soit 9 461 Gkm
en valeur arrondi [G = giga ou
109 km ou milliards] de
km, soit environ 10 000 milliards
de km pour simplifier...
(on peut également parler de mois, jour,
heure, minute et seconde-lumière (m.l,h.l., mn.l., s.l
)
|
Unités >
|
1 jour-lumière (j.l)
|
1 heure-lumière (h.l)
|
minute-lumière (mn.l)
|
seconde-lumière (s.l)
|
|
Distance parcourue >
|
25 902 068 371,2 km
|
1 079 252 848,8 km
|
17 987 547,48 m
|
299 792,458 km
|
Quelques distances moyennes (à
partir de la Terre) exprimées en s, mn, h ou
année lumière
:
|
Lune
|
Soleil
|
Système solaire
|
Étoiles proches
|
Galaxie
(diamètre)
|
Groupe local de galaxies
|
Rayon de l'univers
observable
|
|
env. 1,28 s.l
|
env. 8,32 mn.l
|
env. 5,5 h.l
|
env. 5 a.l (*)
|
env. 100 000 a.l
|
env. 2,5 milliards d'a.l
|
environ 46,6 milliards d'a.l
(**)
|
(Neptune, planète la plus lointaine du
Soleil, est située à 4,17 h-lumière du
Soleil)
*4,244 a.l pour le système le plus proche, Alpha du
Centaure C, lien)
**âge de l'univers : environ 13,7
milliards d'a.l.
> voir liste
des étoiles proches.
- Un parsec (pc) = 3,08567758×1016
m (ou 3, 08567758 x1013 km),
distance à laquelle 1 ua sous-tend un angle
de 1 seconde d'arc.
- (soit environ 206 265 UA, ou 3,2616
années-lumière) -
Nota : 1Mparsec = 3,26 millions d'al
- (1 a.l = 63 241,077 ua environ, et 0,306598 pc) -
L'eau
dans l'espace
intersidéral.
Pour "fabriquer" de l’eau, il faut de
l’hydrogène et de l’oxygène.
L’hydrogène ne manque pas dans l’Univers
puisqu’il représente à lui seul plus de 70 % de
toute la masse visible de l’Univers. En revanche,
l’oxygène est plus rare : il ne représente
qu’environ 1 % de cette masse. Mais surtout, des conditions
précises doivent être réunies pour que des
molécules d’eau puissent se former à partir de ces
deux constituants et perdurer dans le milieu interstellaire.
Le milieu doit être en effet :
- "froid" car la molécule d’eau ne supporte pas des
températures supérieures à quelques milliers
de degrés, mais pas trop car sinon les réactions de
formation de cette molécule deviennent très
lentes,
- exempt de rayonnement ultraviolet, car ce rayonnement dissocie
les petites molécules.
Or, l’espace interstellaire est justement, le plus souvent,
chaud, vide et traversé par ce type de rayonnement. C’est
pourquoi il n’y a pas plus d’eau dans l’Univers. La
quantité d’eau effectivement présente est
très difficile à estimer. On l’évalue
à environ un millionième de la masse totale de
l’Univers visible.
Sous forme de vapeur ou de glace, on trouve l’eau principalement
dans l’atmosphère des étoiles "froides" : naines
brunes détectées récemment, peu massives et trop
froides pour donner lieu à des réactions de fusion
nucléaire, et les vieilles étoiles que sont les grandes
étoiles rouges, dans les nuages protoplanètaires
situés autour d’étoiles jeunes, dans les
enveloppes d’étoiles en fin de vie, dans certains nuages
de gaz du milieu interstellaire, et bien sûr dans le
système solaire.
Par ailleurs, l’eau ne peut subsister à
l’état liquide que dans un domaine étroit de
température et sous une pression suffisante, des conditions
que l’on ne peut rencontrer que sur les planètes et leurs
satellites : pour l’instant, la seule région de
l’Univers où les scientifiques ont pu détecter de
l’eau liquide est le système solaire.
Précisions :
Le milieu interstellaire.
Compris entre les étoiles, le milieu interstellaire
est très ténu, constitué de grains de
poussière et de gaz atomique et moléculaire. La
poussière absorbe la lumière visible et U.V., augmente
la température, et re-rayonne dans l'infrarouge. Des
investigations de recherches dans ce sens sont importantes pour la
recherche de l'eau, glace et des molécules organiques
(observations aux longueurs d'onde situé dans le
proche-infrarouge).
La nébuleuse.
Vaste nuage de matière interstellaire où la
densité est nettement supérieure à celle de
l'espace interstellaire. La matière contenue dans ce nuage est
composée de poussières et de gaz.
Le gaz est un mélange de molécules variées dont
des alcools, de l'ammoniac, des aldéhydes (proches des sucres)
et d'eau, en plus de
l'hydrogène moléculaire (H2) qui est majoritaire.
Ces molécules sont issues de la rencontre, et la combinaison,
des atomes produits par l'étoile.
Cet amas de gaz peut provenir d'une explosion unique d'une nova ou
d'une supernova, comme pour la nébuleuse du crabe :
lorsqu’elles arrivent en fin de vie, les grandes étoiles
rouges refoulent vers l’extérieur leur atmosphère
gazeuse qui forme alors autour de l’étoile une immense
enveloppe pouvant atteindre de 10 à 1000 fois la dimension du
système solaire. De telles enveloppes contiennent beaucoup de
vapeur d’eau et de la glace peut
également s’y former lorsque la température y est
suffisamment basse.
Si les scientifiques ont pu élaborer un scénario
expliquant la présence d’eau dans
l’atmosphère de certaines étoiles, la formation
des nuages interstellaires froids, nuages de molécules
situés dans des régions particulièrement
fraîches de l’Univers, n’est pas encore bien
expliqué.
Et c’est dommage car ce sont eux qui contiennent
l’essentiel des réserves d’eau de l’Univers,
principalement sous forme de glace, et qui président à
la formation des étoiles.
C’est un nuage de ce type qui a donné naissance au
système solaire.
Les étoiles "chaudes".
Les étoiles dont la température de surface
s'échelonne de 5 000 à 40 000 °C ne peuvent
évidement pas posséder d'eau liquide ou solide,
et encore moins dans les couches plus profondes : les noyaux peuvent
être, en fonction de leurs types, de leurs durée de vie,
avoir des températures se situant de 3 000 000 à 800
000 000 °C !
Certain pourtant, auraient trouvé de la
vapeur
d'eau en surface du Soleil ? !
Étonnant car l'eau commence à se décomposer en
hydrogène H2 et oxygène O2 vers
2000°C, ce qui est certain en revanche, c'est la mesure
d'eau moléculaire dans les
atmosphères des étoiles avortées de type naines
brunes (T env. 1500 K).
Et par ailleurs, une équipe démontrait en 2014 avoir
observé des nuages d’eau
à la surface d’une naine brune WISE J0855-0714
(famille d’étoiles minuscules dont la
masse est légèrement supérieure à celle
de Jupiter).
Rappel : le point critique (T : 374°C et
P : 218 atm), est celui au delà duquel l’eau ne
peut plus se trouver sous forme liquide, mais gazeuse.
Déclaration d'Ewine Van Dishoeck de l'observatoire de Leyde :
"Cette abondance remarquable nous informe que l'eau joue un
rôle important dans la naissance des étoiles".
Celui-ci dont l'équipe d'astronomes néerlandais et
suédois a utilisé le spectromètre à
longueurs d'ondes courtes d'ISO pour ce travail, dit également
: "La formation des étoiles résulte de la
condensation d'un nuage de gaz et de poussières, mais la
production de chaleur à l'intérieur du nuage rend plus
difficile le travail de la pesanteur dans son effet de compression du
nuage. En rayonnant fortement dans l'infrarouge, l'eau permet aux
nuages d'éliminer très efficacement la chaleur. Cette
fonction de refroidissement propre à l'eau facilite la
formation d'étoiles. ISO nous donne ainsi une nouvelle clef de
l'astrophysique

L'eau
dans le système solaire.

Mercure - Vénus
- Terre (Lune)
- Mars - Jupiter -
Saturne - Uranus -
Neptune
(pour accéder à chaque planète,
cliquer sur son nom)
-------------------------------------------------------------------------------
Formation du système solaire
(scénario actuel le plus
décrit).
La Voie Lactée contient de nombreux nuages interstellaires,
issus de nébuleuses. Ces nuages, sont composés d'atomes
: de l'hydrogène aux atomes lourds, mais aussi de
molécules à base de carbone, d'hydrogène,
d'oxygène et d'azote.
Un des scénarios de formation possible : lorsque le nuage
originel du système solaire commence à se
comprimer, des étoiles naissent, certaines se
transforment en supernova. L'explosion qui en est liée
favorise l'agglomération des poussières en
éléments plus gros. La contraction de la matière
continue, et au centre du nuage, là où elle est le plus
intense, la température s'élève suffisamment
pour permettre la synthèse d'hélium à partir de
l'hydrogène : le soleil
notre étoile est créé !
Les poussières, lors de leur agglomération dans un
domaine proche du soleil, perdent les matières volatiles
(Hydrogène, Hélium,... ). Au
delà de 750 millions de km du soleil, par contre,
poussières et matières volatiles coexistent. Les
scientifiques ont longtemps cru que
l’eau du système
solaire avait été synthétisée, sous forme
de vapeur d’eau, par oxydation de l’hydrogène
présent en grande quantité au sein de la
nébuleuse primordiale qui entourait la toute nouvelle
étoile, lors de la formation des planètes.
Mais depuis peu, des analyses plus précises de
météorites ont permis de conclure qu’il n’en
est rien, ou du moins que ce n'est pas la seule raison.
L’eau du système solaire émanerait-elle pour
l’essentiel du milieu interstellaire ?
Nota : on observe, à proximité des étoiles en
fin de vie, de la vapeur d'eau résultant de la combinaison
d'hydrogène primordial et des atomes d'oxygène que
viennent de produire les étoiles elles-mêmes.
Sous l’effet de l’intense
chaleur dégagée par la fournaise solaire primitive,
toutes les poussières du nuage interstellaire originel se
seraient vaporisées et les glaces
d’eau qui les recouvraient se seraient
sublimées.
Par la suite, environ un million d’années plus tard,
poussières et vapeur d'eau se
seraient recondensées, formant des grains constitués de
matériaux hydratés qui, en se rassemblant de proche en
proche, auraient donné naissance aux 9 planètes du
système solaire, à leurs satellites et aux
météorites. Très loin du brasier, en
périphérie, la vapeur d’eau aurait gelé sur
des poussières interstellaires qui, en s’agrégeant
les unes aux autres, auraient formé les comètes.
Cette découverte de l’origine interstellaire de
l’eau du système solaire est d’importance : elle
suggère que l’eau du
système solaire ne proviendrait pas d’une circonstance
singulière ayant permis d’enclencher des réactions
chimiques particulières, mais au contraire d’une
situation tout à fait reproductible ailleurs dans
l’Univers. Autrement dit, rien n’empêche de penser
que d’autres planètes existent dans l’Univers qui
possèdent de l’eau, et pourquoi pas, comme la Terre, de
l’eau liquide.
Accrétion (formation des planètes).
Le comportement de la partie gazeuse du nuage (Hydrogène
et Hélium) à dû être différent de
celui de la partie plus lourde du nuage (poussières).
En effet les parties légères, gazeuses, se sont
échappées dans l'espace, les particules rocheuses et
métalliques sont restées sur place. Ces
éléments grossirent de plus en plus en s'entrechoquant
et en s'assemblant. C'est ce qu'on appelle l'accrétion.
Plus un objet sera lourd plus il attirera les
autres en raison d'une gravité plus forte. C'est pourquoi les
plus gros rochers deviendront des planètes. Le
phénomène d'accrétion provoque un
dégagement d'énergie lors de l'impact et le
dégazage des corps sous l'effet de la chaleur (en particulier
de la vapeur d'eau). Les gaz vont ainsi former une
nouvelle atmosphère riche en
vapeur d'eau.
Pourquoi, seule la surface de
la terre contient de
l'eau
sous l'état
liquide, solide (glace)
ou
gazeux ?
Rappel :
- le passage de l'état solide à l'état
liquide est la fusion,
- le passage de l'état solide à l'état
gazeux est la sublimation,
- le passage de l'état liquide à l'état
solide est la solidification,
- le passage de l'état liquide à l'état
gazeux est la vaporisation,
le passage de l'état gazeux à l'état liquide
est la condensation.

Réponse : en traçant sur un diagramme, les
courbes pression=f(température), et donc les limites qui
séparent un état d'un autre, on comprend mieux !
Les trois limites se joignent en un point unique, appelé
"point triple". C'est à dire que, à la
température et à la pression qui définissent ce
point (plus précisément, voir ce
lien),
l'eau peut être à la fois solide, liquide et
gazeuse.
Cette caractéristique est propre à l'eau, les autres
éléments n'ont pas de point triple, seulement des
"points double".
et, suivant le diagramme de phase de l'eau :

Ainsi donc, par rapport aux pressions au
sol et températures des planètes telluriques, la Terre
est la seule des planètes qui permette d'obtenir
l'eau, naturellement
dans ses trois états du moins en
surface... :

Europe, Ganymède et Callisto (satellites de
Jupiter), et Titan (satellite de
Saturne) posséderaient peut être de
l'eau liquide
sous une épaisse couche de glace.
A
écouter, sur ce
sujet sur (Ciel
& Espace -
Radio)
> L'eau dans le système
solaire :
- Sous
les lunes de Jupiter, la quête de
l’eau
(avec Olivier Grasset,
planétologue, laboratoire de Planétologie et
géodynamique de l’Université de
Nantes),
- Une
averse de comètes à l'origine des océans
?
(avec Dominique
Bockelee-Morvan astronome à l'observatoire de Paris
Meudon).
Ci-joint : ordres de grandeurs
"supposées" en quantités de
glace
(calculées), des satellites des lunes
des planètes (telluriques ou non).
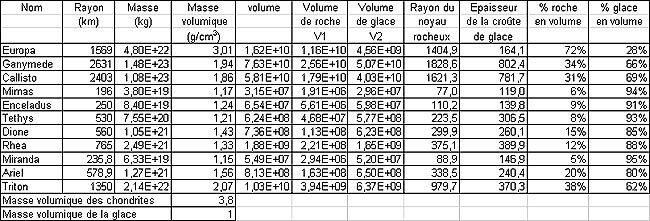
Nota : en supposant que le satellite est
structuré en deux couches.
(Ces résultats ne sont bien sûr que des
ordres de grandeur car ils négligent, entre autres choses, la
variation de la masse volumique des matériaux avec la
profondeur.)

Organisation du système solaire
planétaire et la présence d'eau.
Sites à visiter > Le
Système Solaire à portée de votre souris -
Visiter le système
solaire avec Google Maps !
> le Soleil
(diamètre moyen : 1 392 684 km, masse : 1,9891.1030
kg)
(Gravité à la surface : 273,95 m
s-2, Température : - à la surface > 5 750
K - au centre > 15,1 MK)
(lien)
Les planètes telluriques : 
ce sont des astres à composition semblable à la Terre,
donc des éléments solides par rapport aux
planètes géantes qui sont principalement gazeuses (en
majorité).A noter que les diamètres (s'ils sont
indiqués) sont équatoriaux.
(cliquer sur le nom de la planète pour avoir des
précisions)
Les planètes géantes :
On parle aussi de planètes gazeuses ou de planètes
joviennes (astres à composition semblable à Jupiter).
Ces planètes possèdent toutefois des satellites de type
tellurique. L'atmosphère de ces planètes est proche de
la composition de la nébuleuse primitive. Toutes
possèdent des anneaux constitués d'une myriade de blocs
de glace, de roches et de poussières. ce sont les restes des
particules et agrégats du bombardement d'accrétion,
prisonniers de l'attraction des planètes.
(cliquer sur le nom de l'astre pour avoir des
précisions)

- à noter également, les
planètes naines telluriques :
à 414,704 millions de km environ du Soleil,
Cérès - 974,6 ± 3,6
km de diamètre équatorial
(environ 3.5 fois moins que celui de la Lune)
- qui est située dans la ceinture des astéroïdes
(entre Mars et Jupiter), et qui serait plus
gros astéroïde de la ceinture principale
(> image
récente).
En 2012, il a été identifié de l'eau sous forme
de vapeur sur sa surface (la sonde Dawn s'est
satellisée autour en mars 2015).
De nouvelles études en 2020, confirment l'existence d'un
océan d'eau salée à l'état liquide sous
la surface de Cérès.
Nota - 2 autres corps planétaires sont les plus importants
astéroïdes de cette région spatiale :
- Vesta (diamètre : 560 × 544
× 454 ± 24 km, > image;
- Pallas (diamètre
582 × 556 × 500 ±
18 km, image;
Tableau des 5 principaux astéroîdes de la ceinture
principale :

- et puis, beaucoup plus loin vers la ceinture de Kuiper
(32 UA env. voir ci-dessous), de nouveau des
petites planètes naines, Pluton et Charon dont
on connaît peu de choses - à noter que depuis 2006
Pluton ne fait plus partie des planètes "normales" du
système solaire- > article)
:
Ceinture de
Kuiper (ou
d'Edgeworth-Kuiper) : c'est une
concentration de petites planètes,
d’astéroïdes et de noyaux cométaires
située au-delà de l’orbite de Neptune, entre 30 et
quelques centaines d’unités astronomiques, les
KBO (Kuiper Belt
Object). Les astronomes y ont découvert plusieurs corps
aux dimensions particulièrement importantes (quelques
exemples, mais la liste n'est pas close...) :
Eris (+ 1 satellite > Dysnomia)
: objet découvert (29/07/2005) à
environ 15 milliards de kilomètres de la Terre
(env.100 UA), avec son diamètre de
2.336 +/- 12 km (2015),
il se classerait alors derrière
Pluton (2 370 km de diamètre).
Sedna : à environ 13 milliards de
kilomètres de la Terre au plus proche (orbite
de 87 à 960 UA), l'objet été
découvert par la NASA le 6/03/2004. Du nom de la déesse
Inuit génitrice des créatures de l'Arctique il est trop
gros pour être classé parmi les astéroïdes
mais trop petit pour que les astronomes lui confèrent le
statut de planète. Avec un diamètre vers 1800 km, sa
taille équivaut à peu près à la
moitié de la Lune.
Quaoar : sa découverte à 6,5 milliards
de kilomètres du Soleil en juin 2002, au Caltech à
Pasadena (Californie), était venue bousculer la
hiérarchie. Diamètre : 1 200 /1300 km.
Orcus : de diamètre environ 1600 km a
été découvert
(17/02/2004) à environ 6 milliard de km
du Soleil, et récemment des astronomes français et
italiens ont détecté de la
glace sur sa surface.
Varuna : observé grâce au Spacewatch
Télescope (université d’Arizona).
Au moment de sa découverte : environ 1000 km de
diamètre. Son albédo de 7 % (pouvoir
réfléchissant de la lumière solaire par sa
surface) révélait une surface plus sombre que celle de
ses deux voisines.
Autres objets de taille relativement importantes :
Haumea (2003
EL61) , D=
env.1960×1518×996 km, distance : 35 UA
<orbite> 51 UA (+2 satellites),
> voir ici, photo de
Ultima Thulé, rebaptisé Arrokoth en 2019
(Périhélie : 6,3878.109
km (42,699 UA),
Aphélie : 6,8790.109 km
(45,983 UA)) -
planétoïde survolé en janvier 2019 par la sonde
spatiale New Horizons.$,
Makémaké (2005 FY9), D =
entre 1300 et 1900 km; a environ 52 UA
du soleil (envir. 7,78×109 Md
km),
2007 OR10, rebaptisé Gonggong en 2020, D=1535
km, et son satellite de 300 km, à 101 UA du Soleil.
Les dénominations en attente viennent de l'IAU
, <International Astronomical Union
>.
Nota : lien
de NASA/JPL sur les planètes du système solaire
(en anglais).
La sonde New Horizons devrait entre 2019 et 2021 visiter plus de
vingt corps de la ceinture de Kuiper, en étudier les
propriétés de surface et la forme, et rechercher la
présence de satellites. Elle étudiera aussi
l'environnement spatial de la ceinture de Kuiper : hélium,
vent solaire et particules chargées.
Nota : images reconstituées
(modélisation 3D) de l'objet le plus lointain
observé par la sonde, Arrokoth (ancien. Ultima Thulé)
>
 ...
...
Curiosité : Votre poids sur les planètes >
site
en français.
suite
En plus de ces planètes, il existe une barrière
d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter,
dont certains sont assez imposants (33 ont plus de 200 km de
diamètre, dont
Cérés[974 km],
Pallas[538 km] et
Vesta[500 km]).
Leur nombre est estimé à plusieurs millions. Certains
pensent d'ailleurs que Phobos et
Deïmos (satellites de Mars), ainsi que certains
satellites des planètes gazeuses sont des
astéroïdes piégés par la
gravité.
Ces astéroïdes sont les météores
et météorites
qui frappent la Terre lorsqu'ils quittent leur orbite et rencontre
notre planète.
Le dégazage de ces météorites donne un fluide
composé d'environ 60 à 80 %
d'eau, 19 à 39 % de
CO2 et de méthane et 1 % d'azote, argon et soufre.
Cette atmosphère se retrouve dans les émissions
gazeuses volcaniques de la Terre, c'est l'atmosphère de base
des planètes telluriques.
Comètes.:
Enfin les dernières formations que l'on connaissent dans notre
système solaire sont les comètes. Les comètes
proviennent de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort qui sont
situés aux confins du système solaire, à plus
d'une année lumière du soleil. On pense qu'il y aurait
plusieurs centaines de milliards de noyaux cométaires dans ces
formations.
L'eau est un
constituant essentiel des comètes
Les comètes sont des petits corps du système
solaire, d'une taille de l'ordre de quelques kilomètres,
constitués essentiellement de
glaces et de
roches. Comme les planètes, elles sont soumises au
champ de gravitation solaire. Elles se déplacent sur des
orbites très excentriques, qui les emmènent, dans
certains cas, à de très grandes distances du Soleil,
au-delà de l'orbite des planètes géantes.
Loin du Soleil, les comètes ne sont constituées que de
leur noyau, ce qui les rend inaccessibles à l'observation.
Mais lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, la
température superficielle de son noyau s'élève
et ses glaces se subliment, entraînant l'éjection de gaz
et de poussières. Ce sont ces poussières qu’il est
alors possible d’observer depuis la Terre car elles diffusent la
lumière solaire. On voit ainsi apparaître une
"chevelure" qui s'étend au fur et à mesure que la
comète se rapproche du Soleil. Puis on voit parfois se
dessiner deux queues : l'une, large et incurvée, due à
des poussières qui diffusent la lumière solaire ;
l'autre, étroite et rectiligne, due à des gaz
ionisés dont la fluorescence est excitée par le
rayonnement solaire.
L'analyse à distance, par spectroscopie, du nuage de gaz qui
s'échappe des noyaux cométaires nous permet d'en
déduire la composition :
- l'eau (environ 80 % en nombre de molécules),
- le monoxyde et le dioxyde de carbone (CO et
CO2),
- le méthanol (CH3OH),
- le formaldéhyde (H2CO),
- l'ammoniac (NH3),
- le sulfure d'hydrogène (H2S),
- des hydrocarbures (méthane CH4,
acétylène C2H2, éthane
C2H6).
D'autres molécules, des molécules soufrées,
des cyanures et des molécules organiques plus complexes, sont
détectées à l'état de traces.
Cette composition, qui retrace celle des glaces cométaires,
ressemble fort à celle observée pour les glaces
interstellaires.
L'eau contenue sous forme de glace dans les noyaux cométaires,
en se sublimant entraîne les autres molécules volatiles
et les particules de poussière. Cette production d'eau est
d'autant plus importante que la comète est proche du Soleil.
Mais à plus de 4 unités astronomiques, la glace d'eau
n’est pas suffisamment chauffée par le Soleil pour se
sublimer : l'activité cométaires qu’il est
cependant possible d’observer parfois est alors due à la
sublimation de molécules plus volatiles, comme le monoxyde de
carbone.
Lors de son passage près du Soleil, la comète de
Halley, dont le diamètre du noyau est de 10 kilomètres,
produisait 30 tonnes d'eau par seconde. Avec un noyau
d'environ 50 kilomètres, la comète géante
Hale-Bopp en produisait 300. Une comète plus modeste comme
la comète Wirtanen ne produit que 300 kilogrammes d'eau par
seconde, mais la taille de son noyau n'est que d' 1
kilomètre.
L'eau qui s'échappe ainsi des comètes ne reste pas
intacte. Elle est rapidement dissociée (en quelques heures),
sous l'influence du rayonnement ultraviolet solaire, sous la forme de
radicaux OH et d’atomes
H et O.
NOTES (Jacques
Crovisier - Observatoire de Paris).
Les comètes sont-elles vraiment
à l'origine de l'eau terrestre?
Tous les corps du système solaire sont bombardés
sans cesse par des astéroïdes, des comètes et
autres petits corps. La présence de cratères d'impact
sur la Lune, et sur d'autres planètes ou satellites, en est la
preuve.
On estime que ce bombardement était bien plus intense
autrefois. D'où l'hypothèse que les chutes de
comètes sur Terre auraient pu contribuer à la
composition actuelle de son atmosphère et de ses
océans. En particulier, la glace des comètes aurait pu
apporter l'eau des océans.
Un test important permettant de comparer l'eau cométaire
à l'eau terrestre est la mesure de la proportion de
deutérium dans l'eau.
Il a été possible d'observer HDO et de mesurer ainsi le
rapport deutérium/hydrogène dans l'eau de quelques
comètes. On trouve ainsi un enrichissement en deutérium
d'un facteur 10 par rapport au milieu cosmique (où D/H =
1/30000) et à la Nébuleuse primitive qui a donné
naissance au système solaire.
Cependant, la concentration en deutérium est deux fois plus
élevée dans l'eau cométaires que dans l'eau
terrestre. Ce qui suggère une autre origine pour l'eau
terrestre, plus certainement les
astéroïdes.
Mais cette conclusion n'est peut-être pas définitive.
Elle est basée sur l'étude du deutérium dans
seulement trois comètes, toutes à longue
période, la période d’une comète
étant d’autant plus longue que la comète passe
plus de temps loin du Soleil.
On ignore encore tout de ce rapport pour les comètes à
courte période, qui ont probablement été plus
nombreuses à percuter la Terre, et qui ont suivi une histoire
différente.
NOTES (suite) :
Selon une découverte récente
(fin 2005), l'eau des
océans terrestre viendrait presque exclusivement des
astéroïdes
[météores
et météorites
].
Selon les scientifiques, vers la fin de la formation de la Terre,
celle-ci aurait subie un intense bombardement par des
astéroïdes porteurs de
glace d'eau; on vient
d'ailleurs de découvrir certains de ceux-ci encore
présents dans la "ceinture d'astéroïdes" se
trouvant entre les planètes Mars et Jupiter, et "actifs"
puisque dégageant de l'eau comme
les comètes !Raccourcis : L'eau
dans le système solaire
Egalement > en 2014 une équipe dirigée par
l’astronome Ilsedore Cleeves (université
du Michigan) a mené l’enquête sur
l’hydrogène et la proportion de
deutérium (2H, ou D, est
composé d’un proton et d’un neutron), un de
ses isotopes naturels dans l’eau. Le rapport de celle-ci
enrichie en 2H, également appelée eau
lourde, avec l’hydrogène ne dit pas dans quelle mesure
cet élément a résisté aux conditions
infernales qui régnaient dans la nébuleuse
protosolaire.
Après tout, si l’essentiel du deutérium avait
disparu, notre jeune Soleil n’aurait-il pas pu en recréer
?
Plusieurs des ingrédients requis étaient effectivement
réunis : basses températures, présence
d’oxygène et un rayonnement solaire potentiellement
important à ses débuts.
Aussi, pour le savoir, les chercheurs ont-ils repris la recette
à travers des modèles informatiques afin
d’observer l’apparition éventuelle de cet isotope
sur une période simulée d’un million
d’années. Mais cela n’a vraisemblablement pas
suffi… Le rapport deutérium-hydrogène obtenu est
sans équivalent avec ce qui est constaté
aujourd’hui, 4,56 milliards d’années après la
formation des planètes, dans l’eau terrestre ou celle
amassée par exemple par les comètes (celles-ci sont
considérées comme de véritables machines
à remonter le temps, car elles conservent de la matière
présente dans le Système solaire primitif).
L’équipe conclut que jusqu’à 50 % de
l’eau de notre petite planète bleue proviendrait du
milieu interstellaire. Conel Alexander l’astrobiologiste
(institut Carnegie) explique : « nos résultats
montrent qu’une part significative de l’eau du
Système solaire, l’ingrédient le plus fondamental
pour favoriser la vie, est plus âgée que le
Soleil, ce qui indique que des glaces riches en matière
organique pourraient être trouvées dans tous les jeunes
systèmes planétaires ». C’est
plutôt une très bonne nouvelle pour les chasseurs de vie
extraterrestre. « Il faut suivre
l’eau » (« follow the water »)
arguent les scientifiques (c.f. Nasa). - [Sources : Xavier
Demeersman, Futura-Sciences].
Nota : le rapport D/H de l'eau des océans de la Terre
est de 1,55 10-4 . La valeur du rapport D/H terrestre
étant comprise dans la gamme des rapports D/H des
astéroïdes situés entre Mars et Jupiter,
l’eau des océans sur Terre pourrait ainsi provenir
préférentiellement des astéroïdes et de
certaines comètes. Ces résultats importants viennent
d'être publiés en 2014 dans la revue Science
Express.

Valeurs des rapports deutérium/hydrogène (D/H) dans
différents objets du Système solaire, regroupés
par couleur avec les planètes et satellites (bleu), les
chondrites de la ceinture d’astéroïdes (gris), les
comètes originaires du nuage de Oort (violet) et les
comètes joviennes (rose). © B. Marty,
Esa, Altwegg et al.
Soleil
(image - lien
web)
Précisions : les temps - heures,
jours, années - sont donnés en références
à la Terre.
(source principale : NASA/JPL -
08/2014)
Une des milliards
d'étoiles qui peuplent la Voie Lactée
(notre
galaxie)
----------
Diamètre du
soleil
(équatorial) : 1 391 000 km.
Masse :1,989 x 1030 kg
Période de rotation :
env. 26,8 jours
(terrestres)
à l'équateur et 36 jours vers les
pôles.
------
C'est sa température de surface de 5777 kelvin
(*),
qui produit un rayonnement dans le jaune
(la
température centrale serait de 15,4 millions de
Kelvin)
----------------
Principales composantes
chimiques :
Hydrogène = 92,1% - Hélium = 7,8% -
Oxygène = 0,061%
Carbone = 0,030% - Azote = 0,0084% - Néon =
0,0076%,
[et d'autres
éléments à l'état de
traces]
|
*Unité de
température thermodynamique (K). Elle commence
à la température absolue.
0 K équivaut à -273°C
(l'eau se transforme en glace à 273 K
et bout à 373 K, à PN).
RETOUR
(sytème solaire)
Mercure
(image) (vidéo,
12 mn)
Distance au soleil
(moyenne) : 57 909 227 km
(0,387
UA)
Rotation : 58,6462 jours terrestres - Durée
de révolution : 87,97 jours terrestres
Diamètre : 4879,4 km (équatorial)
Atmosphère
très ténue (He[42%], Na[42%]
et O2[15%]
- P
=10-15
bars)
----------
Température maximum au sol (face
éclairée) : -173/427 °C
-----------------
------Absence
d'eau au sol : mais présence de glace,
et peut être de la vapeur d'eau atmosphérique
(?)
|
Notes : la sonde Messenger a découvert dans ses
régions polaires de vastes quantités de glace.
RETOUR
Vénus
(image) (vidéo
YouTube, 44 mn)
Distance moyenne au soleil : 108,209 millions de
km
(0,723
UA)
Rotation : 243,018 jours (sens
rétrograde) - Durée de
révolution : 224.7 jours,
(le jour vénusien dure environ 117
jours terrestres)
-----------------
Diamètre : 12 103.6 km
(équatorial).
Elle est entourée d'une couche de nuages opaques
en haute altitude.
Ceux-ci se déplacent à plus de 360 km/h. On y
rencontre des cristaux de CO2, des gouttelettes d'acide
sulfurique et de SO2, de la vapeur
d'eau.
Seulement 2 % de lumière solaire passe vers le sol
(30% pour la Terre).
L'hydrogène libéré s'est
échappé et l'oxygène a oxydé le
sol (d'où la couleur
ocre-rouge).
Température moyenne au sol :
456.8°C.
Atmosphère : CO2
[96%] et N2
[3%],
Pression (atmosphère) :
93 000 hPa (93 bars ou 91,78 atm),
soit environ 94 fois celle de la Terre.
------------------
Activité géologique importante. Absence de
vie.
|
RETOUR
Terre (image)
Distance moyenne au soleil
: 149,6 millions de km
(1
UA)
Rotation : 23,56 heures (jour sidéral) -
Durée de révolution : 365 1/4 jours
Diamètre : 12 756,2 km équatorial, et
polaire : 12 713,6 km.
Masse : 5,973.1024 kg
---------
Pression moyenne de l'atmosphère au
sol : 101 325 Pa (1013,25 hPa, soit 1,013
bar).
Température moyenne au sol :
15°C
(pression et
température décroissent avec l'altitude,
à 12 km la pression est 7 fois plus faible qu'au
sol
et la température baisse de
70°)
Composition de l'atmosphère : 78,09 % d'azote,
20,95 % d'oxygène, 0,93 % d'argon, 0,03 % de CO2
---------
La position de la Terre par rapport au soleil, la
présence de saisons et de climats différents
ainsi que la présence d'eau liquide ont permis
l'apparition de la vie.
------------
Satellite : la Lune
Totalité du volume
d'eau
terrestre : évaluée à 1 358
266 020 km-cubes
[km3],
ou 1,358.1018
m3
(1,3
Em3)
dont :
eau liquide = 1 329 081 627
km3,
glaces = 29 158 567
km3,
eau atmosphérique = 12 913
km3
(Rappel : 1 km3 =
1 milliard de m3, ou 109 m3)
|
Aujourd’hui, si l’on pouvait éroder tous les
reliefs de notre planète, l’eau liquide recouvrirait
toute sa surface formant une couche de 3 kilomètres
d’épaisseur, une situation très différente
de celle de ses consœurs !
RETOUR
la Lune
(image)
Distance moyenne à la Terre : 384 400 km
(mais, éloignement de 4 cm par
an)
Diamètre : 3 476 km
(équatorial), soit 27% env. du
diamètre terrestre.
Masse : Masse : 7.349 x 1022 kg
--------
Rotation : 27 j. 8 h - Durée de
révolution autour de la Terre : 27 j. 8 h
Température au sol (face
éclairée) : de +100 le jour à -50
°C la nuit ,
face non éclairée : -150 °C .
Pas d'atmosphère.
Certains scientifiques américains ont annoncé
qu'il y aurait de l'eau
sur la Lune ?
(sous forme de
glace
bien sûr ! - Lien sur > futura-ciences).
En fait, des données récentes
(images de la sonde Kaguya)
contrediraient cette annonce peut
être un peu rapide...donc, à suivre
(peut être grace à la
sonde Lunar Reconnaissance Orbiter [LRO]
?
|
A noter que certains satellites des planètes autre que la
Terre ont un diamètre supérieurs à la Lune :
Ganymède, Titan, Callisto et Io
RETOUR
Mars
(image)
Distance moyenne au soleil : 228,943 millions de
km (1,53
UA)
Diamètre : 6 779 km (équatorial).
Rotation : 24,623 heures - Durée de
révolution : 686,98 jours
(1 an et 321,7 jours
terrestres)
------------------
Température moyenne, au sol : -63°C
Les températures vont de -128° C
(la nuit aux pôles en hiver)
à +27 °C (en été
à l'équateur)
Atmosphère : 95,3 % de
CO2, 2,7 % d'azote
[N2], 1,6% d'argon
[Ar], 0,07 % de monoxyde de
carbone [CO], 0,13 %
d'oxygène
[O2],
et 0,03 %
de vapeur
d'eau.
Pression de l'atmosphère : en moyenne de 600
Pa (0,6 kPa, soit 6
millibars),
[soit environ 1.7 fois moins que sur la
Terre]
-------------------------
2 satellites : Phobos
(image)
et Deïmos (image)
Présence de calottes
glaciaires au niveau des pôles : elles piègent
un mélange d'eau et de neige carbonique. Il n'y a pas
de présence d'eau liquide au
sol*,
bien que les anciens lits de fleuves trouvés,
indiquerait que celle-ci était présente il y a
quelques millions d'années.
Peut-être dans le
sous-sol ?
|
*La faible
valeur de la pression atmosphérique ne permet pas à
l'eau liquide d'exister à la surface de Mars.
L'eau ne peut donc exister de façon permanente en surface que
sous forme de gaz (vapeur
d'eau) ou de glace.
-----------------
Lien interne sur les missions vers Mars : ici
Lien web à visiter :
Mars >
The Mars Exploration Program
<Overview>
RETOUR
Jupiter
(image)
Distance moyenne au soleil : 778,340 millions
de km (5,2
UA)
Rotation : 9.92496
heures - Durée de révolution : 11 ans 313
j
Diamètre : 139 822 km
(équatorial,
> polaire : 113 628 km, P=1
atm)
Température au
plafond des nuages :
-145 °C (au
centre de la planète : environ 20 000
K)
Il n'y a pas de surface rigide
(l'atmosphère
est constituée à 90 % d'hydrogène et
environ 10% d'hélium)
avec de petites quantités de méthane,
d'ammoniaque et
d'eau,
et d'autres éléments, mais le centre doit
être constitué par un noyau liquide
d'hydrogène métallique.
Jupiter possède des anneaux en faible quantité
et très fins.
Aucune vie de type terrestre possible.
--------------------
Principaux satellites (par
ordre de grandeur) : Ganymède
(1), Callisto (2),
Io (3) et Europe
(4)
- 80 corps satellitaires, 72 sont
officiellement numérotés, dont 57
nommés (2021) -
|
(1) Ganymède (image)
:
Distance de Jupiter : 1 070 000 km -
Diamètre : 5 262,4 km - Masse :
1,4819.1023 kg
Ganymède se compose très probablement de noyau
rocheux (et peut être une part
métallique), avec un manteau
d'eau glacé et une
croûte de roche qui se compose très
probablement de glace et de
silicates, et sa croûte est probablement une couche
épaisse de glace et
d'eau.
Il y a sous la surface, un
océan d’eau liquide
et salée.
< voir page
sur cette lune >
|
(2) Callisto (image)
:
Distance de Jupiter : 1 883 000 km -
Diamètre : 4 820 km - Masse :
1,08.1023 kg
Callisto semble se composer d'une croûte d'environ 200
kilomètres de profondeur.
Sous la croûte, existerait un
océan d'eau salé
de plus de 10 kilomètres.
Les météorites ont perforé des
trous en croûte de Callisto, faisant répartir
l'eau
sur la surface
(glace)
et formant des rayons et des anneaux autour des
cratères.
|
(4) Io (image)
Distance de Jupiter :
421 800 km - Diamètre : 3 643,2 km
(±1,0)
- Masse : 8,93.1022 kg
Ce satellite se compose principalement de roches avec un
petit peu de fer.
Un volcanisme actif sur Io a été la
plus grande découverte. Les panaches des volcans se
prolongent à plus de 300 kilomètres au-dessus
de la surface, la lave étant
éjectée
et accélérée à 1 km/s.
Io est par ailleurs situé dans une intense ceinture
de rayonnement : les électrons et les ions
emprisonnés dans le champ magnétique de
Jupiter. Certains des ions plus énergiques (soufre et
oxygène) tombent le long du champ magnétique
dans l'atmosphère de la planète Jupiter, ayant
pour résultat des aurores.
Peut être de l'eau
à l'état de
vapeur (?)
|
(3) Europe (image)
:
|
Distance de Jupiter : 670 900 km -
Diamètre : 3 121,6 km - Masse :
4,80.1022 kg
Sa surface éclatante et presque lisse serait,
d’après les dernières données
envoyées par la sonde Galileo, une
banquise
(environ 40/100 km
d'épaisseur) sous laquelle il pourrait y avoir
un océan d’eau liquide
et salée. Ce serait les mouvements d'eau
liquide qui entraîneraient ces fissures. De l'acide
sulfurique
(H2SO4) a
été trouvé sur la surface gelée
de cette lune glaciale, et également de
l'oxygène moléculaire
(O2) dans
l'atmosphère.
< voir page
sur cette lune >
|
A
écouter
(Ciel
& Espace -
Radio)
> Sous
les lunes de Jupiter, la quête de
l’eau
(avec Olivier Grasset,
planétologue, laboratoire de Planétologie et
géodynamique de l’Université de Nantes.
Responsable scientifique du projet
Laplace).
RETOUR
Saturne
(image)
Distance moyenne au soleil
: 1 426 666 422 km
(9,536
UA)
Diamètre moyen : 116 464 km
(équatorial)
Rotation : 10,656 hours
- Durée de révolution : 29 ans &
168 jours.
Température moyenne des nuages : -125 °C - au
centre de la planète : env. 14000 K
---------------------------------------
Saturne est entourée de centaines d'anneaux
(500 - 1000) formés de
poussières,
et de débris de roches et de
blocs de glace en orbite autour
de la planète
(du cm à plusieurs mètres).
L'épaisseur des anneaux n'est que de 1,5 km, alors
que ceux-ci s'étalent sur plusieurs milliers de
km.
---------------
- 274 satellites ont leurs
orbites confirmées
[2025]
Parmi lesquels 53 ont été
nommés, dont Encelade (1),
Téthys (2),
Dioné
(3),
Rhea
(4),
Japet
(6), mais surtout Titan
(5)
> (voir ci-dessous, classement par ordre de
proximité avec Saturne
)
|
(1) Encelade (image)
Planète tellurique
située à 238 020 km de Saturne.
Diamètre moyen (eq.) : 498 km - Masse
: 8.419
kg
Formée principalement de de silicates et de
fer,
Encelade serait recouvert de
glace
"propre", on observe des
"geysers froids" formés de
vapeur et
glace
d'eau ".
Selon un
modèle, les jets de vapeur et de particules de glace
émanant des « rayures de tigre »
proviendraient de réservoirs souterrains d'eau
liquide sous pression
(océan
?), et
s'échapperaient par des bouches de sorties ayant
« percé » la croûte à cet
endroit.
|
> Voir une image
récente de geysers (2009) et page
sur cette lune
(2) Téthys (image)
Planète tellurique située
à 294 660 km de Saturne.
Diamètre (eq.) : 1060 km - Masse :
6,22.1020 kg
Elle serait composée principalement de de
glace d'eau et de
roches.
|
(3) Dioné (image)
Planète tellurique située
à 377 420 km de Saturne.
Diamètre (eq.) : 1120 km - Masse :
1,05.1021 kg
Dioné serait composée principalement de de
glace d'eau et de roches (1/3
de sa masse).
|
(4) Rhéa (image)
Planète tellurique située
à 527 040 km de Saturne.
Diamètre éq.: 1530 km - Masse :
2,49.1021 kg
Rhea est composé principalement de
glace d'eau et de
roches
(représentant moins de 1/3 de sa
masse).
|
(5) Titan (image)
- (anim ,
117
Ko)
Planète tellurique située
à 1 221 830 km de Saturne (en
moyenne).
Diamètre
(équatorial) : 5151 km (±4)
- Masse : 1.3455 x
1023 kg
Température au sol :
-179 /-210° C,
eau
et CO2 présents
sont
gelés.
(sauf peut
être en sous-sol...)
Pression
atmosphérique
(mesurée
à la
surface) :
1 467 hPa
(mbar).
L'atmosphère contient surtout de l'azote
(90-98%) et du méthane
(1-6%).
(Il existe des lacs/rivières d'
hydrocarbures à la surface [méthane et
éthane principalemet]).
En dehors de la température,
c'est le seul corps astral qui
possède une atmosphère voisine de la
Terre
(avant l'apparition de la vie
basé sur
l'oxygène).
|
Tour virtuel de Titan
(lien,
en anglais) - Image
Carte du sol (2019)
(6) Japet (Iapetus) (image)
Planète tellurique située
à 3 561 300 km de Saturne.
Diamètre : 1460 km - Masse :
1,88.1021 kg
Japet serait composé principalement de roches (
très peu de glace
d'eau).
|
RETOUR
Uranus
(image)
Distance moyenne au soleil : 2 870 658 186
km (19 UA)
Diamètre : 51 118 +/- 8
km (équatorial)
Rotation (durée): 17,24 heures
(sens
rétrograde)
Durée de révolution orbitale
(années) :
83,75
(Uranus se distingue par le fait qu'elle
est très inclinée sur son axe, soit
97,86°)
------------------
Elle est entourée d'anneaux (9
connus) formés de blocs
de glace pour le premier
et entourés de poussières.
-----------------------------------------
L'atmosphère d'Uranus de se compose de 83%
d'hydrogène, 15% d'hélium, 2% de
méthane
et d'un peu d'acétylène et autres
hydrocarbures.
NOTA : un océan
d'eau,
d'ammoniac et de méthane, extrêmement
pressurisé et conducteur pourrait se trouver entre le
noyau et l'atmosphère (à confirmer
!).
------------------
Principaux satellites : Titania
(1) et
Oberon
(2), Umbriel (3), Ariel (4) et
Miranda (5).
- 27 corps satellitaires connus
(2019)
-
[liste des 16 principaux
satellites > 50 km de
diamètre]
|
(1) Titania (image)
Distance d'Uranus
(moyenne)
: 436 298 km -
Diamètre (eq.)
: 1578 km - Masse :
3,53.1021 kg
Titania est la plus grande lune d'Uranus.
Elle est marquée par quelques grands bassins
d'impact, mais est généralement couverte de
petits cratères et de roches très
rugueuses.
Ce serait un mélange d'environ 40-50%
de glace d'eau, le reste
étant de la roche.
|
(2) Oberon (image)
Distance d'Uranus
(moyenne)
: 583 420 km -
Diamètre (eq.) : 1522,8
(± 5,2)
km - Masse : 3,03.1021 kg
Oberon est une lune d'Uranus qui est
caractérisé par un vieux cratère de
surface glacée.
La surface montre peu d'évidence d'activité
interne autre qu'un certain matériel foncé
inconnu qui couvre apparemment les planchers de beaucoup de
cratères.
(Il y a des rayons semblables à ceux
vus sur la lune de Jupiter, Callisto).
Pas d'atmosphère.
|
(3) Umbriel (image)
Distance d'Uranus
(moyenne)
: 265 980 km -
Diamètre (eq.) : 1 169 km - Masse :
1,27.1021 kg
Umbriel est une lune d'Uranus très sombre. La surface
est fortement cratérisée et a probablement
été stable depuis sa formation.
Elle serait formée d'un mélange de
glace d'eau
(environ 40-50%) et de roche.
|
(4) Ariel (image)
Distance d'Uranus
(moyenne)
: 190 930 km -
Diamètre (eq.) : 1 159 km - Masse :
1,27.1021 kg
Elle serait formée d'un mélange de
glace d'eau
(environ 40-50%) et de roche.
La surface serait un mélange de terrain formé
de centaines de cratères, reliés par un
ensemble de vallées (de centaines de
km de longueur et de plus de 10 km de
profondeur).
|
(5) Miranda (image)
Distance d'Uranus
(moyenne)
: 129 900 km -
Diamètre (moyen) : 471 km - Masse :
6,59.1019 kg
Elle serait formée d'un mélange de
glace d'eau et de roche.
Sa surface semble composée de glace d'eau
mêlée à des composés de
silicates,
et de carbonates ainsi qu'à de l'ammoniac.
lPar ailleurs, la surface comprend de vastes plaines
vallonnées piquées de cratères et
traversées par un réseau de failles
escarpées et de rupes.
Elle présente surtout trois impressionnantes
couronnes, aussi appelées « coronae »,
dont les diamètres dépassent les 200
km.
|
RETOUR
Neptune
(image1, image2)
|
Distance moyenne au soleil :
4 498 396 441 km (30,
06 UA)
Rotation : 16,11 heures - Durée de
révolution orbitale
(années)
: 164.79132
Diamètre : 49 520 km
(équatorial).
--------------
L'atmosphère de Neptune se compose de 85%
d'hydrogène, 13% d'hélium, 2% de
méthane.
C'est le méthane
qui donne à Neptune sa belle couleur
bleue.
Température moyenne des
nuages : -193 à -214°C.
Les deux tiers
internes de Neptune seraient composés d'un
mélange de roche fondue, d'eau, d'ammoniaque
et de méthane liquide. Le tiers externe est un
mélange de gaz chaud comprenant de
l'hydrogène, de l'hélium, de l'eau et
du méthane.
Neptune a quatre
anneaux, lesquels sont très étroits et
pâles. Les anneaux sont faits de particules de
poussière issues de l'impact de petites
météorites sur les lunes de Neptune.
Principaux satellites
(par ordre de tailles) :
Triton(1),
Proteus (2)
et Nereide
(3).
- 14 corps satellitaires connus
(2019)
-
|
(1) Triton (image)
- (anim,
171 ko)
Distance de Neptune (en
moyenne) : 354 760 km
Diamètre (équatorial)
: 2 706,8 km - Masse :
2,139.1022 kg.
Triton a une densité moyenne d'environ 2,059
g/cm3 (densité de l'eau : 1,0
g/cm3). Ceci signifie que Triton contient plus de
roche à l'intérieur que les satellites de
glaces de Saturne et d'Uranus.
La plupart des structures géologiques sur la surface
de Triton sont probablement constituées de
glace d'eau.
La température sur la surface est environ 38 kelvins
(-235°C) : la surface la plus
froide de n'importe quel corps actuellement visité
dans le système solaire, excepté Pluton.
Il y a une
atmosphère, très ténue (environ 0,01
millibar), composée principalement d'azote avec un
peu de méthane. et
contient
des neiges
d'azote.
Egalement des geysers ont été observés
(2009).
|
(2) Protée ou Proteus (image)
Distance de Neptune : 117 600 km
Diamètre : 418 km (436 x 416 x
402) - Masse : 5.1019
kg
Protée est une lune avec une surface sombre.
Elle est fortement cratérisée et ne montre
aucun signe d'activité géologique.
Pas d'eau trouvée
(2019).
|
(3) Nereïde (image)
Distance de Neptune (moyenne) : 5 513
400 km
Diamètre (D) :
340 km - Masse : 3.1019
Son orbite est la plus fortement excentrique de n'importe
quelle planète ou satellite du système
solaire, sa distance à Neptune variant de 1 353 600
à 9 623 700 km; ses caractéristiques indiquent
qu'elle serait peut être un asteroïde
capturé (ou un objet de la ceinture
de Kuiper).
Pas d'eau
trouvée (2019).
|
[ les autres lunes sont : Larissa (D:194
km), Galatea (176 km), Despina
(150 km), Halimede (62
km), Laomedeia (42 km), Naiad
(66 km), Neso (60 km),
Psamathe (40 km), Sao (44
km), Thalassa (82 km) et
Hyppocamp (18 km) ]
( source
(2019) :
NASA)
RETOUR
Pluton & Charon (image,
2015)
Pluton
(image 1,
image 2,
2015)
Distance moyenne au soleil : 5, 906 milliards
km (39,48 UA)
Diamètre
(équatorial)
: 2379,8 +/- 4 km -
Rotation : 6, 38 jours
(rétrograde)
Durée de révolution orbitale
(années terrestre) : 248
(90 560 jours)
(mis à jour 2017)
-----------
Composition atmosphérique :
Azote (99%), méthane et
dioxyde de carbone.
Pluton est si loin du soleil que même l'azote, l'oxyde
et le di-oxyde de carbone, les gaz de méthane
gèlent partiellement sur sa surface ; T°C (sol)
: -220/-230
-
présence
d'eau en
surface, sous forme de glace (et
même de montagnes de glace d'eau),
(Pluton aurait un
océan
sous sa surface de glace ?)
---------------------------------------------------
Nota* :
outre Charon (voir
ci-dessous), 4 petites "lunes" ont
été découvertes autour de Pluton :
Nix (D=42 km), Hydra
(D=55 km), Kerberos (D=12 km) et Styx (D=7
km).
( images
Nix et Hydra )
|
Charon
(image,
2015)
Distance de Pluton (moyenne) : 19 640
km,
Diamètre : 1208 km env (50%
env. du diamètre de Pluton)
Rotation : 6,38 jours - Durée orbitale
: 6,38 jours (terrestres, autour de
Pluton)
- glace
d'eau détectée en
surface.
|
(*
fournies par la sonde New Horizons,
2015/2016)
RETOUR
------------------------
(source principale : NASA/JPL -
03/2010-2015)
Liens web de ce chapitre : http://www.nineplanets.org/
, solarviews
et Ciel &
Espace
|
Fin du chapitre L'eau
ailleurs
|




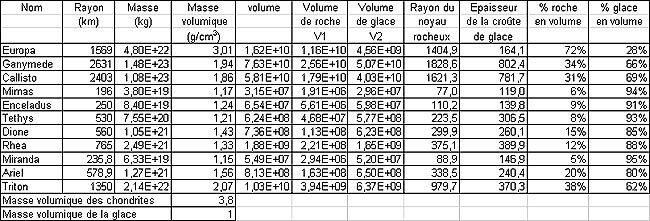


 ...
...
