
|
|
Remarque préliminaire :
Les nuages sont l'expression la plus importante des
phénomènes qui se produisent dans la troposphère.
Puisqu'ils sont visibles, les nuages nous donnent rapidement une
bonne idée du temps qu'il fait : nuage d'orage ou inoffensif
cumulus !
Étapes de la formation d'un
nuage.
L'air clair (absence de nuages) contient toujours des
particules microscopiques invisibles à l'oeil nu. On les
appelle "noyaux de condensation ou de
congélation", constitués de particules provenant
des éruptions volcaniques, de poussières
arrachées au sol, de poussières de combustion, de
pollens, ect. Et peut être d'une action des rayons cosmiques
(Sciences et Avenir, N° Hors-Serie,
octobre/novembre 2012, pages 37/38).
Par ailleurs, l'air peut contenir un maximum de vapeur d'eau, maximum
qui dépend en fait de sa température; lorsque ce
maximum est dépassé, on dit que l'air est
sursaturé.
Les molécules de vapeur d'eau contenues dans l'air vont donc
se condenser en eau liquide au contact des noyaux de condensation ou
encore se solidifier au contact des noyaux de congélation si
la température est inférieure à 0 °C. L'eau
liquide condensée sur les particules microscopiques va par la
suite s'évaporer et retourner dans l'air sous forme de vapeur
d'eau.Tant que le nombre de molécules de vapeur d'eau qui se
condensent est égale au nombre de molécules qui
s'évaporent d'une particule, il ne peut y avoir formation de
gouttelette d'eau. Cependant, lorsque la température de l'air
est suffisament basse, le nombre de molécules qui se
condensent devient plus grand que le nombre de molécules qui
s'évaporent.
À partir de ce moment, on dit que l'air est
sursaturé de vapeur d'eau et il y a formation d'une
gouttelette d'eau : les nuages sont formés de plusieurs
millions de ces gouttelettes. En réalité, les nuages se
forment lorsque de l'air qui contient de la vapeur d'eau est
soulevé en altitude. La parcelle d'air qui part du sol
contient une certaine quantité de vapeur d'eau qui ne change
pas durant son ascension.
Puis, en se soulevant, l'air prend de l'expansion (car la pression
atmosphérique diminue en altitude), sa température
diminue et son humidité relative augmente.
Nota : l'air peut être soulevé de différentes
façons :
À une certaine altitude, l'humidité relative est suffisamment élevée pour que la parcelle d'air devienne sursaturée et une partie de la vapeur d'eau se condense sur les noyaux de condensation (ou congélation). À partir de ce moment, des gouttelettes ou des cristaux commencent à se former :
(l'eau sous forme de vapeur dans l'air est invisible, mais elle
peut devenir visible lorsqu'elle retourne à l'état
liquide [eau] ou solide [glace]).
Nota : la dissipation des nuages à l'inverse de
leur formation, se produit lorsque l'air en altitude subit un
réchauffement et donc un assèchement relatif de son
contenu en vapeur d'eau, puisqu'un air chaud peut contenir plus de
vapeur d'eau qu'un air froid. Ce processus est favorable à
l'évaporation, ce qui dissipe les nuages.
Le réchauffement de l'air en altitude est souvent causé
par une subsidence de l'air (déplacement d'air
vers le sol dans l'atmosphère) qui entraîne une
compression
adiabatique de celui-ci.

Description des types
de nuages.
Toutes les classifications sont inspirées de celle de
Howard (chimiste anglais,1803).
La classification la plus récente est celle de
l'Organisation météorologique mondiale
publiée en 1956 dans l'Atlas international des nuages.
Le tableau ci-dessous présente les quatre principales familles
de nuages de ce système (Ahrens, 1994).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
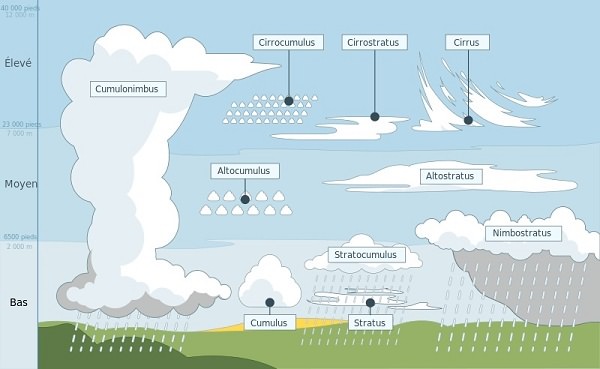
Nota :
- des nuages proches du sol (arcus) en forme de rouleau horizontal,
dense (souvent accompagné de pluies et de
rafales de vent grêle, signe précurseur d'orage)
:

- des nuages (nuages nacrés) se trouvent à 15-25
kilomètres d'altitude, au dessus donc de la troposphère
(jusqu' à 8 à 15 kilomètres de
hauteur),
- des nuages (nuages noctulescents) se trouvent à 80-85
kilomètres d'altitude dans la mésosphère,
partie atmosphérique comprise entre 50 km et 80 km d'altitude,
au-dessus de la stratosphère, et proche de l'espace :

Chaque famille est subdivisée selon
l'aspect. Un nuage qui présente une base uniforme sans
détails repérables, par exemple, est appelé
« stratus » alors qu'un nuage dont la base a une
configuration ou une structure bien définie est appelé
« cumulus » ou nuage de « type cumulo » .
Certains nuages sont surtout des nuages à
précipitations et sont alors appelés « nimbus
».
Même si les nuages sont en constante évolution, on a pu
définir un nombre limité de formes
caractéristiques permettant de les classer en
différents groupes. La classification des nuages de l'Atlas
international des nuages compte dix groupes principaux,
appelés "genres"
:
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Notes :
À l'intérieur des nuages, les molécules
d'eau contenues dans la vapeur se condensent, s'attirent et font
naître entre elles une force de cohésion qui leur permet
de former des gouttelettes. Celles-ci se percutent et
s'agglomèrent ensuite sous l'effet d'un
phénomène physique désigné sous le terme
de coalescence pour devenir des gouttes d'eau de pluie.
Lorsque les nuages se situent à une altitude inférieure
à 2.000 mètres, les turbulences atmosphériques
sont faibles et limitent le phénomène de coalescence.
La taille des gouttes reste elle aussi limitée. Leur
diamètre ne dépasse pas 1 millimètre. On parle
plutôt de bruine.
Dans les nuages plus élevés, entre 2.000 et 5.000
mètres, les turbulences sont plus importantes et le
diamètre des gouttes peut atteindre 6 millimètres.
C'est d'ailleurs la taille maximale que l'on puisse observer pour une
goutte de pluie qui tombe. Car, au cours de sa chute, la goutte est
soumise, en plus de la force de tension superficielle qui fait sa
cohésion, à une force de friction due aux frottements
avec l'air. Lorsque les gouttes sont trop volumineuses et atteignent
ces fameux 6 millimètres de diamètre, cette force de
friction entraîne l'explosion de la goutte en fragments de
tailles inférieures.
La quantité d'eau que
contient un nuage est très importante (mais
variables selon le type de nuage et sa dimension). Les nuages
qui ont une très faible densité, comme les
cirrus, contiennent très peu d'eau liquide puisque ce
sont des nuages de glace situés à haute altitude.
Contrairement aux cumulonimbus qui sont des nuages à
contenus en eau liquide très élevés.
On aura, Mc = le contenu en eau liquide, en g / m3
(exemples, Thompson, 2007
) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La concentration en gouttes d'eau d'un nuage est le nombre de
gouttes d'eau par volume n,
généralement exprimé en centimètre cube
(Wallace, 2006).
La formule est la suivante : n = N/V , avec N
= nombre total de gouttes d'eau et V volume du nuage.
et, Mc = (mLn) / N, avec
mL = la masse d'eau contenu dans
une parcelle d'air.
Ainsi donc par exemple, un cumulonimbus de 4,5 km3
(soit 4,5.109
m3) doit contenir entre
4,5.109 g et
13,5.109 g
environ, soit entre 4 500 et 13 500 tonnes d'eau !
Qui serait donc capable en théorie de déverser au total
(événement très violent avec un
volume de précipitation de 100 mm) cette
quantité d'eau sur 45 000 km² (4,5
millions d'hectares), soit le 1/12 de la superficie de la
France métropolitaine ou la superficie de la région
Midi-Pyrénées.
(rappel : 1 km3 = 109 m3 = 1 000 000 000
m3).
NB :
Le cumulonimbus est le nuage avec le plus d'extension
verticale et l'énergie qu'il renferme peut être
impressionnante : les plus gros pouvant rivaliser avec
l'énergie, en "équivalent TNT", de la bombe atomique de
Nagasaki (21 000 à 23 000 tonnes de
TNT).
La quantité d'eau d'un nuage (gouttelettes
d'eau liquide + cristeaux de glace), donc hors vapeur d'eau et
poussières, ne représenterait qu'un
millionième de son poids total !
(JP. Chalon, EDP Sciences, 2004).
(et lien > https://actu.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-01-17-11h15/combien-pese-un-nuage-23880
Effet d'un temps
nuageux.
Le jour :
Durant le jour, la surface de la Terre est
réchauffée par le Soleil. Si le ciel est clair, presque
tous les rayons du Soleil atteignent le sol. Le sol se
réchauffe et réchauffe à son tour l'air qui est
au-dessus.
Par contre, si le ciel est nuageux, une partie des rayons du
Soleil est réfléchie par les nuages (par les
gouttelettes d'eau et cristaux de glace) vers l'espace. Il y aura
donc moins de rayons solaires qui se rendront au sol pour le
réchauffer. En d'autres mots, le sol va moins se
réchauffer s'il y a des nuages que s'il n'y en a pas. La
température de l'air environnant sera plus faible : il fera
moins chaud.
La nuit :
Durant la nuit, un ciel nuageux provoque l'effet inverse sur la
température de l'air. Si le ciel est clair, les rayons
émis par la surface de la Terre s'échappent vers
l'espace et le sol se refroidit rapidement.
Si le ciel est nuageux, une partie des rayons émis par
la surface de la Terre est absorbée par les nuages. Les nuages
vont émettre à leur tour de l'énergie vers
l'espace et vers la Terre sous forme de rayonnement. Le sol absorbe
les rayons émis par les nuages et se réchauffe un peu.
Par la suite, le sol réchauffe l'air qui est au-dessus. Donc,
si la nuit est nuageuse, la température de l'air se refroidit
moins rapidement que si la nuit était claire. Cela veut dire
qu'il fera plus chaud cette nuit-là.

L’orage (eau-rage,
oh désespoir...) :
La plupart des orages se forment lorsqu’un nuage est
soumis à un soulèvement qui le transporte à une
altitude où la température est nettement plus basse. Le
nuage aspire alors à sa base de l’air chaud et
chargé d’humidité, s’organise en cellule
convective avec en son sein de fortes différences de
densité. Celles-ci amplifient considérablement
l’agitation convective, ce qui permet au nuage d’atteindre
de hautes altitudes où les basses températures
favorisent la condensation de l’eau, la formation de grosses
gouttes puis leur chute en averses abondantes. L’orage
apparaît lorsque, dans ces nuages fortement agités entre
la phase gazeuse légère et ascendante et la phase
liquide constituée de gouttes beaucoup plus lourdes
entraînées vers le sol par gravité, les
frottements sont suffisants pour engendrer une ionisation de
l’air accompagnée d’éclairs et de tonnerre
(dans le nuage électriquement neutre, les charges
électriques positives et négatives se
séparent).
La différence de potentiel à l’origine de la
foudre peut produire un plasma, ce qui cause une expansion explosive
de l’air. L’éclair vu par un observateur
résulte de la dissipation de ce plasma.

L’évaporation de la pluie tombée sur le sol
provoque son refroidissement progressif et celui des couches
d’air voisines, réduisant ainsi la cause de l’orage
: présence d’air chaud et humide dans un environnement
plus froid. À moins qu’un apport d’air chaud et
humide extérieur ne compense ce refroidissement local, la fin
de l’orage est dès lors annoncée.
Lorsqu’une masse nuageuse assez lourde effectue une rotation
suffisante, la cellule convective décrite
précédemment peut évoluer en tornade,
dont la structure se caractérise par un tube d’axe
presque vertical tourbillonnant du nuage au sol ou à la mer,
sans que cela affecte son caractère orageux. Ce tourbillon est
appelé « tuba ». Des circonstances assez
exceptionnelles sont nécessaires pour que, dans la partie
basse de la cellule orageuse, une sorte de toupie se forme et
descende au contact du sol, en concentrant très localement
à la fois la rotation prélevée alentour et la
charge en gouttes (voir figure ci-après). Ce
phénomène est dévastateur.
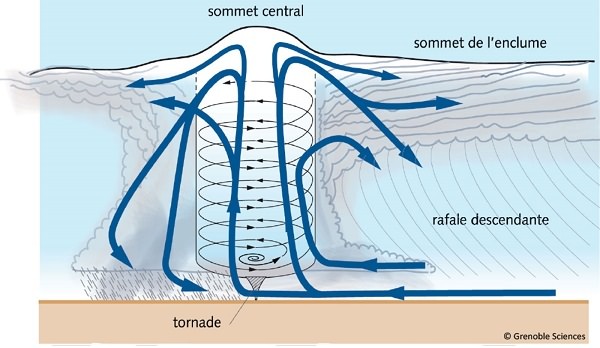
Organisation interne d’une cellule orageuse raccordée
au sol par une tornade. Même si les échelles ne sont pas
rigoureusement respectées, noter la petite taille de la
tornade (hachures grises) par rapport à celle des courants
ascendant et tournant (couleur bleue et pâle). La longueur de
la tornade peut être de 10 à 100 m,
l’épaisseur totale de la masse nuageuse de 5.000 m. Le
diamètre de la tornade peut être de 2 à 10 m,
alors que celui du courant ascendant peut atteindre 100 m. ©
Grenoble Sciences.
Phénomène météo : les nuages
d'ondes de Kelvin-Helmholtz...?
D'étonnantes vagues nuageuses apparaissent parfois
l'espace de quelques minutes avant de disparaître : les nuages
d'ondes (de Kelvin-Helmholtz), qui peuvent donner l'impression
d'observer un tsunami dans le ciel, se forment partout dans le
monde.
Si certains n'hésitent pas à l'appeler « tsunami
de nuages » tant les vagues du phénomène peuvent
être impressionnantes, les ondes de Kelvin-Helmholtz sont
inoffensives : l'observateur sur terre ne risque rien, ni pluie ni
vent ..Mais ces vagues nuageuses témoignent tout de même
d'une forte instabilité présente en altitude : les
pilotes d'avion tentent en général de les éviter
car ces ondes peuvent être à l'origine de fortes
turbulences...L'Atlas international des Nuages a récemment
renommé ce nuage Fluctus (mot latin pour « flotter »
ou « vague »), mais le terme majoritairement utilisé
reste celui de Kelvin-Helmholtz, du nom des deux physiciens qui l'ont
décrit pour la première fois.
Les nuages d'onde de Kelvin-Helmholtz sont
régulièrement aperçus partout dans le monde, et
plusieurs fois par an en France. Cependant, les plus spectaculaires
d'entre eux sont en général photographiés
au-dessus de la mer, près des côtes, ou en montagne,
proches des zones où les courants de vents en altitude sont
plus forts.
Ce même type d'ondes peut se produire dans l'eau, notamment
lors de la rencontre de l'eau douce d'un fleuve qui se jette dans
l'eau salée de la mer. Ici aussi, ce sont les variations de
vitesse et de densité qui génèrent ces ondes
maritimes, parfois visibles dans les images satellites. Les ondes ont
aussi déjà été observées dans les
profondeurs des océans, jusqu'à 500 m sous la
surface...
Dans l'espace, des ondes de Kelvin-Helmholtz ont déjà
été observées autour de la couronne du Soleil,
de Jupiter, de Saturne à la surface d'un nuage interstellaire
??
Explications.
Des ondulations liées à des différences de
vitesses :
Le phénomène se forme à la limite entre les
nuages et le ciel dégagé, lorsqu'une masse d'air chaud
circule au-dessus d'une couche d'air froid, plus basse.
En raison de la présence de forts vents horizontaux, la couche
supérieure se déplace plus rapidement que la couche
inférieure : cette instabilité forme alors des
ondulations, avec des crêtes à son sommet, plus ou moins
spectaculaires en fonction des courants de vent.
Ce sont donc les variations de vitesse entre ces deux couches qui
façonnent ces « vagues » ou « lames »
toujours en mouvement, avec la légère rotation que l'on
peut apercevoir. La couche supérieure est plus chaude, mais
aussi plus sèche que celle d'en dessous en raison de sa
vitesse, ce qui provoque l'évaporation du sommet du nuage de
manière dentelée.
La formation et la déformation du phénomène sont
très facilement observables à l'œil nu et cette
forme étonnante ne dure en général que quelques
minutes, voire même moins d'une minute !
![]() (utiliser
les menus à gauche) ou le retour de votre
navigateur.
(utiliser
les menus à gauche) ou le retour de votre
navigateur.
|
|