Concentrations des boues produites :
|
(filière potabilisation) |
- indicatives - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les boues se présentent donc sous forme d’une
«soupe» qui subit ensuite des traitements visant en
particulier à réduire leur teneur en eau :
épaississement, deshydratation avec ajout important de
chaux.
Mais, à la différence du traitement des boues d'eaux
résiduaires, le dimensionnement d'une installation de
traitement de boues d'eau potable est souvent soumis à des
incertitudes concernant la variation de la qualité de l'eau
brute (phénomènes de crues entrainant des limons et
autres matières facilement décantables).
Il est donc difficile de dimensionner l'installation sur une charge
d'entrée moyenne.
Techniques à appliquer en fonction de la destination finale :
Caractérisation.
Pour connaître le comportement d'une boue avec tel ou tel
type de traitement, une caractérisation poussée doit
avoir lieu. Pour cela, les paramètres qui doivent être
pris en compte sont :
Matières Sèches (MS) : c'est le
paramètre généralement mesuré. La
concentration en MS permet de connaître la quantité de
boue à traiter, quel que soit son niveau de concentration dans
la filière de traitement.
La détermination de la teneur en MS s'effectue à
l'étuve 105°C ou par infrarouge.
Matières En Suspension (MES) : les MS
étant faciles à déterminer sur les phases
concentrées, il n'en va pas de même sur des phases
clarifiées (surverses,
filtrats, centrats...) parce que les concentrations de
matières sont beaucoup plus faibles. Dans ce cas, la mesure
des MES est plus appropriée. Il convient par ailleurs
d'être prudent dans le calcul du rendement de capture qui doit
être exprimé, de préférence, en fonction
des MES (il est possible de déterminer par l'expérience
la relation entre MS et MES).
La détermination de la teneur en MES s'effectue par filtration
sur membrane.
Matières Volatiles (MV, en concentration) ou
Fraction Volatile (FV, en % de MS) : ce
paramètre livre une indication sur le degré de
stabilisation de la boue et son aptitude à divers traitements
(déshydratation, incinération...). Plus le taux de MV
est faible, plus la boue est facile à épaissir ou
à déshydrater, mais plus son exothermicité en
incinération est faible. On considère
généralement que MV = +/- MO
(Matière Organique).
Les boues d'eau potable possèdent de faibles MV (<30 % en
moyenne).
C.H.O.N.S. (Carbone,
Hydrogène, Oxygène, Azote, Soufre) : ce
paramètre permet d'estimer les performances d'une étape
ultérieure de traitement par voie thermique
(incinération) ou biologique (digestion anaérobie avec
production de biogaz, surtout valable pour les boues
résiduaires urbaines).
PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : le
PCI, (à relier au CH.O.N.S), a une importance primordiale en
incinération. Il existe de nombreuses corrélations ou
modes de calcul du PCI.
Par exemple, il est possible d'avancer la corrélation
suivante, en exprimant le PCI en kWh/ kg de MS par rapport à
la fraction volatile : PCI = 0,048 * FV + 1,032.
Eléments-traces métalliques : quelle que
soit la destination finale des boues, la connaissance des teneurs en
éléments-traces métalliques est primordiale,
surtout en cas de valorisation. Les métaux suivants doivent
pouvoir être identifiés : Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd,
Hg, et éventuellement (normes
allemandes) TI (Thallium).
Indice de Boue (IB) : ce paramètre, à
relier indirectement aux MS et MV, dépend du temps de
séjour dans un bassin biologique. Sa bonne connaissance est
importante pour l'épaississement : plus l'IB est faible, plus
la boue est facile à épaissir.
DCO, DBO, PT, NTK : leur connaissance est secondaire
sur une chaîne de traitement des boues.
En revanche, il est important de connaître ces valeurs pour
différents filtrats, centrats et surverses retournant
éventuellement en tête de la file de traitement
eau.
Ceux-ci peuvent couramment représenter 5 à 25 % de la
charge entrante, selon le type et les performances du traitement des
boues.
Graisses : généralement exprimées
en MEH (Matières Extractibles à l'Hexane), elles sont
intégrées aux MV. Elles sont prises en compte dans
toutes les opérations de combustion ou biologiques.
Fibres : les fibres (matières lignocellulosiques
carbonées) peuvent réduire la résistance
spécifique de la boue et, par conséquent,
améliorer sa déshydratabilité.
Elles constituent une partie non négligeable de la fraction
non dégradable des MV.
Agents pathogènes : les agents pathogènes
(surtout présents dans les eaux résiduaires) sont
principalement associés aux MES, et se retrouvent donc en
grande majorité dans les boues.
Il s'agit de virus, bactéries et parasites (Protozoaires,
Helminthes).
La teneur des boues en agents pathogènes est
caractérisée en fonction de la présence des plus
résistants d'entre eux, qui sont donc jugés
représentatifs du risque à estimer : les
Entérovirus (virus), Salmonelles (bactéries) et
œufs d'Helminthes viables (parasites).
Nota : les 5 derniers paramètres sont surtout
intérressant en traitement de boues
résiduaires.
Quantité de boues
produites (en potabilisation)
Estimation de la quantité de MES résultant du
traitement d'un m3 d'eau "brute" :
(formule empirique)
avec,
Estimation de la production de MES à
chaque étape du traitement de l'eau (en
potabilisation) :
1) sur une filière classique (décantation +
filtration), on considérera que 90 à 95% des MES sont
récupérés lors de l'étape de
décantation, et 5 à 10% lors de la filtration.
En fonction de la dilution des purges, le rapport des volumes entre
boue décantée et filtrée varie de 1 à
5.
2) sur un saturateur à chaux (fabrication d'eau de chaux
saturée), on estime les MES récupérées
à environ 15% de la masse de chaux éteinte
introduite.
Les boues sont extraites de la file "traitement eau" à trois niveaux :
Le volume de boues extrait est de l'ordre de 2 à 8% du
volume d'eau traitée produit.
Nota : les débits volumiques sont normalement
quantifiés par un bilan massique effectué sur
chaque étape de la filière de traitement.
Concentrations moyennes des boues
aux différentes étapes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(physico-chimique) |
|
|
|
(surverses d'hydrocyclone) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type de boues :
Afin d'estimer l'aptitude d'une boue à
l'épaississement et/ou à la déshydratation, une
bonne connaissance de sa qualité est indispensable.
En fait, il existe deux grandes familles de boues d'eau potable :
- celles issues du traitement des eaux de surface,
- celles issues du traitement des eaux souterraines (eaux de forages).
Les caractéristiques dépendent donc des eaux
traitées ET du traitement appliqué pour les
potabiliser.
Classement des principaux types de boue :
|
|
|
|
|
|
|
MO > 20 % |
|
|
|
hydroxydes (Fe+Al) < 5 % MO < 10 % |
|
|
|
hydroxydes de fer > 40 % hydroxydes d'aluminium = 4 à 10 % |
Classement des boues.
(selon l'ouvrage "Traiter et Valoriser les Boues"
, livre collectif d'OTV, octobre 1997).
Boues issues des traitement d'eaux de surface (classe 1)
:
Il s'agit généralement de boues hydroxydes (encore
appelées boues de clarification) obtenues par
décantation ou rétention des MES et colloïdes
précipités à l'aide de sels de fer ou
d'alumine.
En fonction de la qualité de la ressource (matières en
suspension dans l'eau brute) elles contiennent une quantité
variable de matières facilement décantables, telles que
de la marne ou de l'argile.
Les boues hydroxydes se répartissent en quatre classes :
Boues issues des traitement d'eaux de forage (classe 2) :
Le cas des boues mixtes :
Les eaux de surface (dures) peuvent faire l'objet d'une
décarbonatation, même si ce cas de figure est assez
rare.
Inversement, les boues de forage peuvent contenir des boues
hydroxydes, à la suite d'un collage aux réactifs. La
filière génère donc une boue mixte.
Les proportions respectives de chaque type de boues permettent de
connaître les caractéristiques du mélange et
d'estimer les performances de traitement.
Spécificité des boues.
1 - Eaux issues des eaux de surface.
Ce sont des boues de type hydrophile. Leur teneur en hydroxydes
et en matières organiques peut considérablement varier,
selon l'origine de l'eau brute. Un niveau élevé de
carbonate de calcium (CaCO3) conjugué à de faibles
teneurs en MO et en hydroxydes, assure une bonne
traitabilité.
En revanche, les boues d'hydroxydes sont fines et
légères, ce qui rend difficile leur
épaississement par décantation.
Exemple de composition de boues hydroxydes et performances de
traitabilité :
(Nota : la siccité définit
le pourcentage de matières sèches [MS] contenu
dans une boue).
1A
1B
1C
1C
1D
(lac propre, barrage)
ou à l' embouchure
(algues,
plancton)
Risques bactériologiques :
2 - Eaux issues des eaux de forage.
Boues de décarbonatation (classe 2 A) : ces boues,
venant des traitements d'eaux de forages dures, contiennent
principalement du carbonate de calcium, qui leur donne un
caractère hydrophobe. Leur traitabilité est donc
très bonne.
Boues de traitement de substances métalliques (classe 2
B) : ces boues, comme les boues de décantation
(chargées en MES) contiennent des hydroxydes de fer (et/ou de
mangansèse); mais ces hydroxydes, formés à
partir de la précipitation du fer (et/ou de
mangansèse), sont constitués de cristaux relativement
purs, entièrement inorganiques et, par conséquent, plus
difficile à traiter.
Traitabilité difficile.
Exemple de composition de boues de forage et performances de
traitabilité :
(physico)
déferrisation (biologique)
avec polymère (g/l)
Boues de traitement biologiques (classe 2C) : ces boues
sont proches des boues de dépollution d'eaux usées.
|
|
|
|
On produit ainsi toute une gamme de boues aux
propriétés diverses : boues épaissies,
déshydratées, chaulées, séchées,
compostées, etc.

Principes des principales techniques.
Stockage -
Tampon.
Remarque : la plupart des boues d'eau potable sont
constituées, en partie, d'eaux de lavage de filtres, qu'il est
nécessaire de collecter et de rendre de même nature
(homogénéisation) dans une cuve-tampon, et ceci avant
de traiter. Ces cuves-tampons peuvent être de deux types :
Notes : il est envisagé quelquefois de renvoyer en
tête de filière la totalité des eaux de
lavage de filtres (après homogénéisation et
stockage). Ce système permet d'écrêter les
volumes sans pertuber le procédé. Les boues sont alors
extraites uniquement au niveau des décanteurs.
Cependant, ce principe n'est pas recommandé : des
protozoaires du type Cryptosporidium ou Giardia risquent d'être
renvoyés en début de filière. Ou bien, un
traitement spécifique (sur ces eaux de retour) doit être
impérativement effectué.
Données basiques de dimensionnent
:
|
(eaux de forage) |
|
|
Soit donc,
1) Epaississeur statique hersé (boues de
traitement des eaux de surface - classe 1).
A noter qu'un polymère (généralement anionique)
peut être utilisé : il doit être du type SEP
(Spécial Eau Potable) lorsque les surverses sont
recyclées (en tête de filière eau). Par ailleurs,
un ajout de chaux permet une amélioration des performances de
décantation : par exemple, avec 25% de chaux (en
Ca[OH]2 / MS) les purges passent d'une
concentration de 10 à 25g/l.
Exemple de performances de l'épaississement (sur
boues issues de décanteurs) :
|
|
|
|
|
|
|
|
(lac propre, barrage) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 à 27 |
|
|
|
|
|
|
2) Epaississeur statique hersé (boues de
traitement des eaux de forage - classe 2).
Contrairement aux boues de station d'épuration d'eaux
usées, très évolutives, les boues d'eau potable
peuvent être épaissies en amont, dans le
décanteur.
Les boues riches en CaCO3 (boues de décarbonatation)
s'épaississent très bien : les concentrations obtenues
peuvent varier de 60 à 300 g/l (fonction du traitement sur la
file eau).
Sinon, il faut noter des performances plus faible : les purges ont
des concentrations d'environ 5 g/l (du fait de l'absence de MES dans
les eaux brutes).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(lac propre, barrage) |
|
|
(ou embouchure) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(MES, mg/l) |
|
|
|
|
|

Dans ce système, la boue est pressurisée dans une
bâche à air (bâche de
pressurisation).

Dans cette configuration, l'eau clarifiée des sousverses
est pressurisée puis détendue et mélangée
à la boue, à l'entrée du flottateur. Il existe
une boucle de recirculation, dans laquelle peut être
injecté la boue brute (système dit à
co-courant), ou introduite dans un pot de mélange situé
dans la cuve (contre-courant).
Exemple de performances de l'épaississement :
(valeurs indicatives)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Fitration sur filtre à bandes
- Fitration sur filtre à plateaux (filtre-presse)
- Centrifugation (décanteuse centrifuge)
- Sac filtrant
- Lit de séchage
- Lagunage
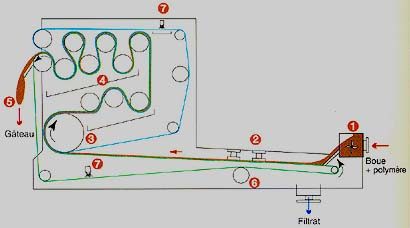
Nota : il existe des filtres à basse et haute
pression (même processus à quelques
différences près).
Le conditionnement s'éffectue généralement
à la chaux (dose de 30% / MS). La siccité
obtenue varie entre 20 et 25% et la teneur en MES des
filtrats est inférieure à 30 mg/l.
NB - ce système n'est pas recommandé pour les boues
organiques (classe 1D), de déferrisation ou
démanganisation (classe 2B), et aussi les boues biologiques
(classe 2C) : risques de collage sur les bandes).
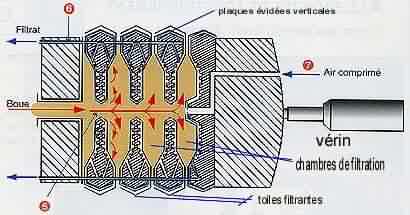
Le filtre est donc formé d'une batterie de plaques
évidées verticales, dotées de toiles filtrantes
serrées sous l'action d'un vérin. Ces plaques forment
alors des chambres de filtration.
La boue à filtrer est injectée sous-pression dans les
chambres (5), où elle s'accumule
jusqu'à former un gâteau compacté. Le filtrat est
recueilli dans des cannelures (à l'arrière du support
filtrant) et évacué par des conduits internes
(6). La pressée se termine
à l'arret de la pompe, puis les circuits de filtrats et la
conduite centrale sont purgés à l'air comprimé
(7).
Débatissage
: le vérin libère la 1ère chambre et
le gâteau tombe gravitairement. Un système
mécanique et automatique permet de dégager ensuite les
plateaux un à un.
1)Conditionnement au polymère
: le taux de traitement est de l'ordre de 0.5 à 1 kg/t MS.
La siccité obtenue varie entre 18 et 20% pour un
temps de pressée de 4 heures.
2)Conditionnement à la chaux (lait de chaux) : le taux
de traitement est de l'ordre de 15% / MS, il permet d'obtenir des
siccités élevées, supérieures à
40%.
La durée de cycle (pressée + débatissage) est de
l'ordre de 2h30. La densité des gâteaux se situe entre
1,15 et 1,20 kg/dm3.
A noter que sur les boues de nature hydroxyde (rivière ou
barrage), la siccité obtenue se trouvera entre
30 et 40% (pour un taux de chaux de 30 à 35% / MS). Exemple de
filtre-presse :

Nota - les capacités des filtres sont rarement
au-delà de quelques centaines de litres.
Equipés de débatisseurs automatiques, ces filtres sont
très compétitifs par rapport aux autres techniques.

Performances - Centrifugation de
boues d'eaux de surface (hydroxydes).
1) Centrifugeuse conventionnelles - exemple (valeurs indicatives)
:
(Nota : le centrat représentent les eaux
séparées des boues après
centrifugation)
(MES mg/l)
2) Centrifugeuse de hautes performances : les siccités
obtenues sont de l'ordre de 20 à 25%, pour des taux de
polymère de 7 à 12 kg/t MS.
Centrifugation de boues d'eaux de forage.
Centrifugeuse conventionnelles - exemple de performances (valeurs
indicatives) :
Nota : la haute teneur en carbonate (CaCO3) des boues de
décarbonatation (classe 2A) amène de bonnes
perfomances.
(MES mg/l)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- S : surface des lits (m²),
- V : volume annuel de boues à traiter (m3),
- N : nombre d’épandage par année,
- H : épaisseur de boues épandues (m).
Par ailleurs, ce procédé nécessitera au moins
deux ouvrages, afin d'alterner les étapes de remplissage et de
séchage sur l'un ou l'autre lit (le nombre total de lit sera
fonction des volumes totaux de boues à sécher).
Les lits devraient être
conçus pour permettre un enlèvement des boues
sèches par des équipements mécaniques comme des
chargeuses frontales.
Remarque : il est possible d'alimenter des lits de
séchage, de boues liquides venant directement d'un
stockage-tampon (voir Option 1). Mais en
principe, les boues sont d'abord épaissies afin de
réduire les cycles de remplissage-séchage
(Option 2).
Option 1 -
Séchage de boues non
épaissies.
(épaissisement et déshydratation en une seule
étape)
Principe de fonctionnement.
1)Phase de décantation et d'épaissisement :
2)Phase de drainage :
3)Phase de séchage et de raclage :
Option 2 -
Séchage de boues
épaissies.
Principe de fonctionnement.
1)Phase de filtration et d'extraction :
2)Phase de drainage et d'évaporation :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(obtenue au bout d'une année) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 lagunes en parallèle (terrain argileux) |
Normes AFNOR.
A consulter éventuellement :
T97-001 (novembre 1979) Essais des boues - Détermination des
caractéristiques en liaison avec l'aptitude à la
concentration.
NF U44-108 (octobre 1982) Boues des ouvrages de traitement des eaux
usées urbaines - Boues liquides - Échantillonnage en
vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot.
Indice de classement : U44-108.
Publications contenant cette norme : Matières fertilisantes et
supports de culture - Échantillonnage, analyses chimiques et
essais physico-chimiques.
NF U44-110 (octobre 1982) Boues - Amendements organiques - Supports
de culture - Préparation des échantillons partiellement
secs pour essai - Expression des résultats.
Indice de classement : U44-110.
NF U44-171 (octobre 1982) Boues - Amendements organiques - Supports
de culture - Détermination de la matière
sèche.
NF EN ISO 8780-1 (mai 1995) Pigments et matières de charge -
Méthodes de dispersion pour évaluer la
dispersibilité - Parties 1, 2, 3, 4 et 5.
Indices de classement : T31-210-1 / T31-210-2 / T31-210-3 / T31-210-4
/ T31-210-5.
NF EN 12579 (juillet 2000) Amendements organiques et supports de
culture - Échantillonnage,
Indice de classement : U44-101.
Publications contenant cette norme : matières fertilisantes et
supports de culture - échantillonnage, analyses chimiques et
essais physico-chimiques.
Site internet > Normes
AFNOR.
Téléchargement d'un programme de
calcul et de dimensionnement des boues (potabilisation) <
TBEP, 163 ko> : ici
ou voir d'abord ce lien
d'informations.
|
|